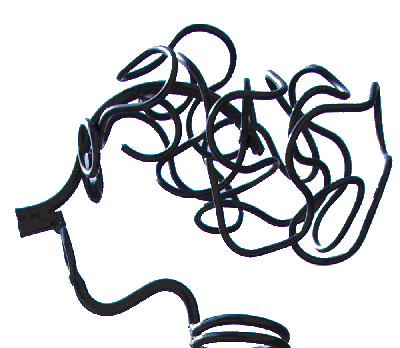Le monde animal bouge, collabore… et communique (4) : Sans
microorganismes, pas de À la recherche du temps perdu !
Étonnant contraste entre la petitesse de la fourmi et la puissance de
tout ce que collectivement elles peuvent réaliser. Dans mon article « La fourmi est petite, mais la fourmilière est grande », je présentais plusieurs de
leurs prouesses les plus spectaculaires : la capacité de construire des
ponts vivants pour franchir un obstacle, la fabrication d’un radeau étanche
protégeant la reine et permettant de survivre aux inondations, l’invention de
l’agriculture ou de l’élevage, trouver le plus court chemin entre deux points,
optimiser la circulation… J’y évoquais aussi les performances des abeilles qui
ne sont pas en reste en matière de prouesses collectives.
Le monde animal est ainsi peuplé d’espèces qui, faibles individuellement,
sont fortes grâce à des propriétés qui émergent collectivement, c’est-à-dire
des propriétés qui n’existent pas au niveau d’un individu, mais qui ne se
manifestent qu’au niveau du groupe : une fourmi seule ne pourrait ni
trouver le plus court chemin, ni résister à une inondation, ni faire de
l’élevage de puceron ; une abeille seule serait de même incapable de
trouver les meilleures fleurs…
Fascinante puissance du groupe.
Mais au fait, est-ce que chaque individu est conscient de ces propriétés
émergentes ? Ou formulé autrement, une fourmi ou une abeille
comprennent-elles ce qu’elles font et pourquoi elles le font ? Quand
une fourmi s’associe à ses voisines pour créer un radeau et permettre à la
fourmilière de devenir insubmersible, sait-elle ce qu’elle fait et pourquoi
elle le fait ? Ou quand une autre de ses congénères se livre à la culture de
champignons, est-elle consciente de participer à créer une nourriture
indispensable à la survie future ? Et quand d’autres viennent au secours de
nymphes pour faire partir des prédateurs, ont-elles en tête le nectar que cette
même nymphe pourra donner en retour ?
Difficile de répondre à une telle question, non ?
Probablement un peu, sinon comment imaginer que chacune pourrait se
prêter efficacement à sa tâche. Mais probablement pas complètement, car on ne
voit pas bien comment la complexité de l’ensemble irait se loger dans la
petitesse d’une seule. Une forme d’intelligence distribuée, en réseau :
j’agis avec juste les informations nécessaires à mon action, mais sans savoir
les buts finaux de mon action, buts qui me dépassent.
Sautons à un tout autre aspect de ce monde animal, et de ses
emboîtements, à celui de ces multitudes d’organismes vivants qui habitent
chacun de nous. Ils sont des millions de milliards à se promener sur nous et en
nous. Infinité de la vie, de ses cohabitations et de ses articulations.
Chacun de ces microorganismes vit à son rythme, suit sa propre logique,
subit les influences de ce qui l’entoure et contribue sans le savoir à la
dynamique d’ensemble. Parmi ce troupeau invisible, certains nous sont nuisibles, d’autres au contraire sont
nécessaires au bon fonctionnement de notre corps, contribuant à sa survie.
Repensons alors à la scène fameuse de Marcel Proust trempant sa madeleine
et se retrouvant brutalement replongé dans son enfance à Combray chez sa tante
Léonie. L’écriture de cette scène n’a été possible que grâce à l’existence de
ces microorganismes qui habitaient le corps de Marcel Proust. D’une certaine
façon, on se trouve à nouveau devant une propriété émergence : pas de
microorganismes, pas de À la recherche du
temps perdu.
Mais cette fois l’émergence est lointaine, et non pas de proximité comme
avec les fourmis et les abeilles de tout à l’heure. Et plus de doute à
avoir : ces microorganismes ne peuvent pas même imaginer ce à quoi ils
contribuent. Soyons rassurés, leurs descendants ne vont pas venir demander leur
part des droits d’auteurs !
(à suivre)